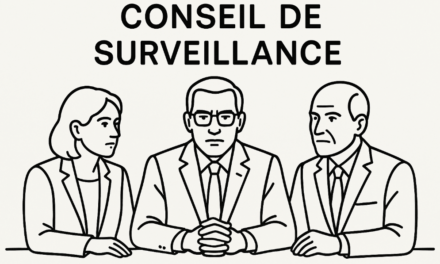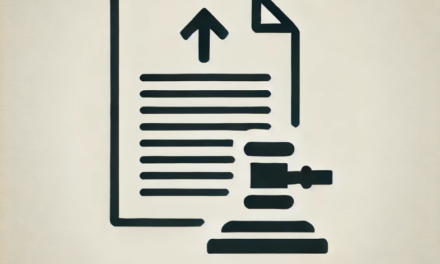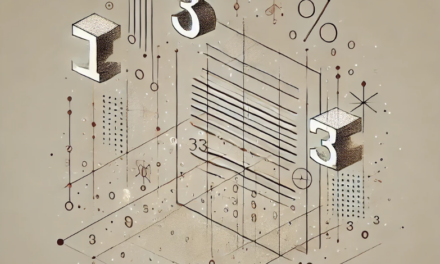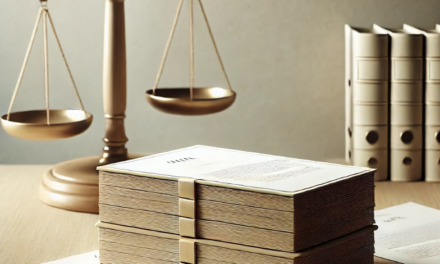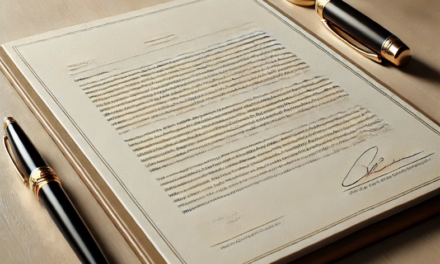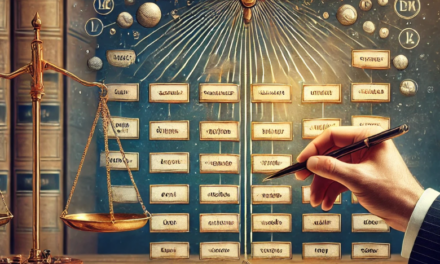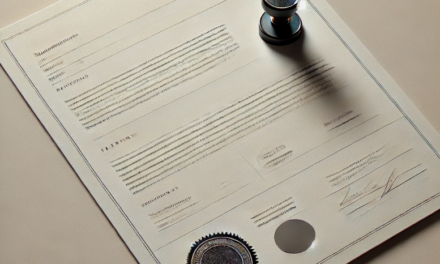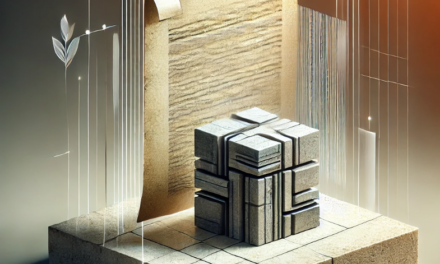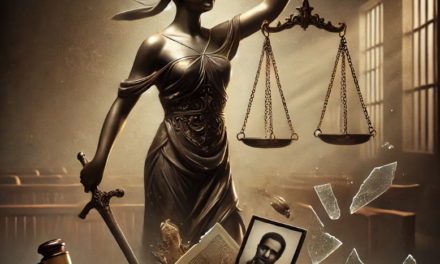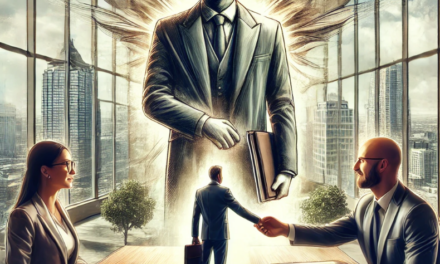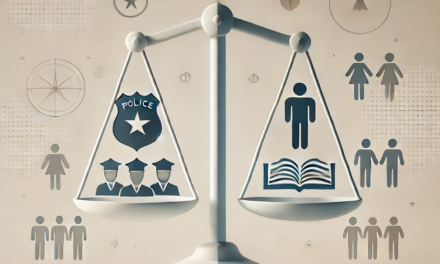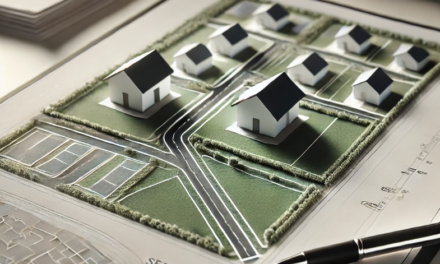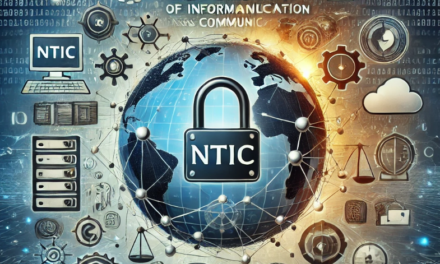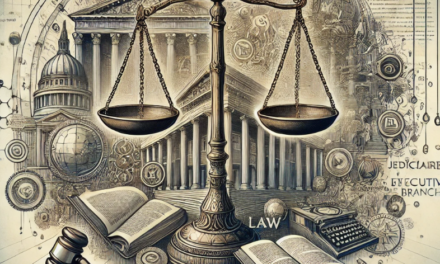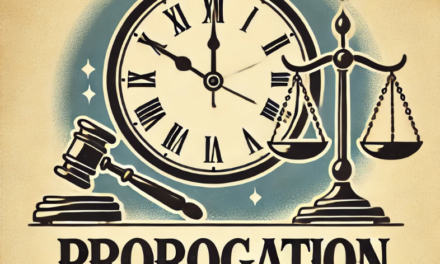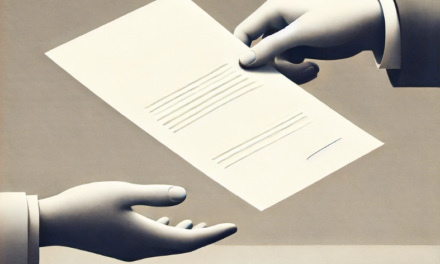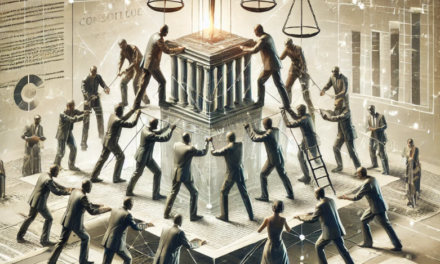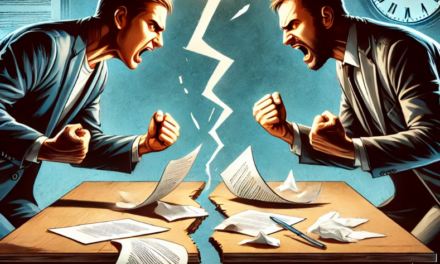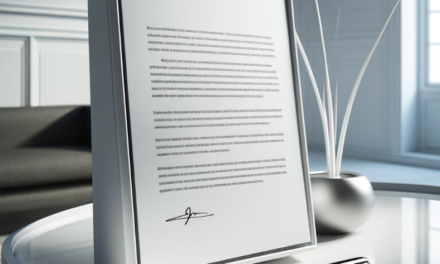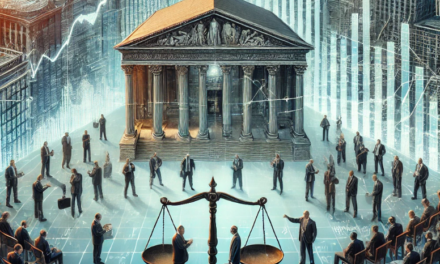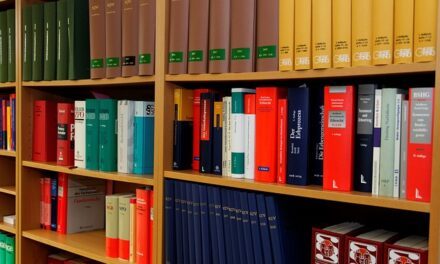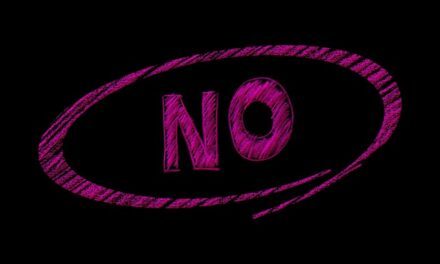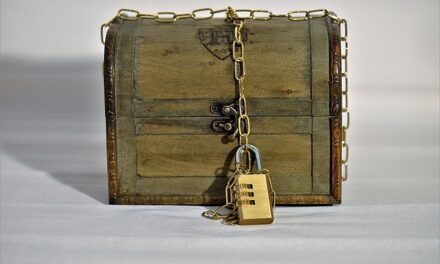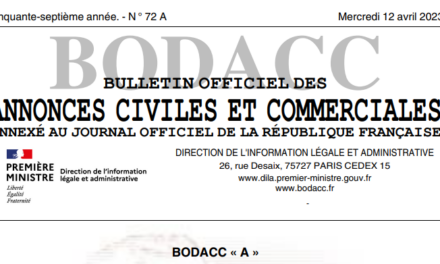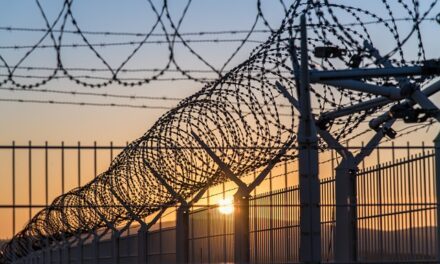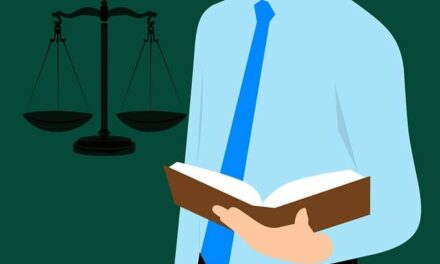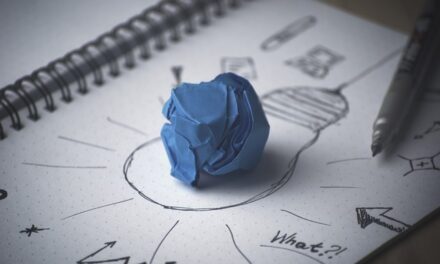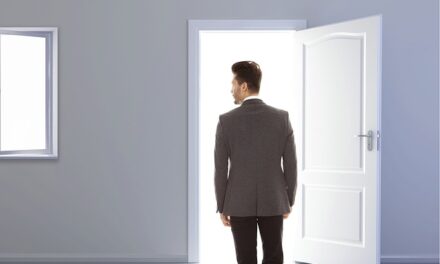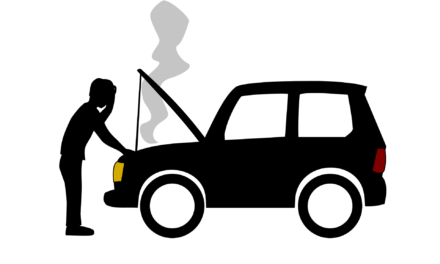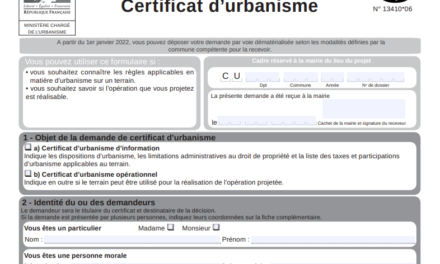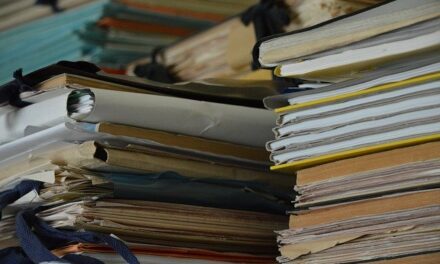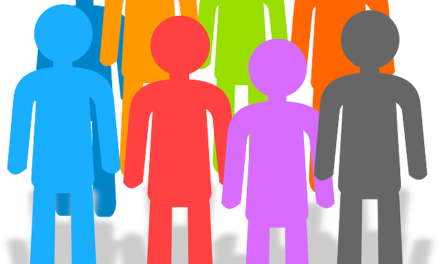La notion de « de cujus », abrégée de l’expression latine « is de cujus successione agitur », signifie « celui dont la succession est en cause ». En droit des successions, ce terme désigne la personne décédée dont les biens vont être transmis à ses héritiers. Bien que ce terme soit couramment utilisé, il est absent du Code civil, qui lui préfère des expressions comme « le défunt » ou « le disposant » lorsqu’il s’agit d’une succession testamentaire.
Le régime juridique du de cujus repose sur plusieurs principes essentiels, notamment la dévolution successorale, la liquidation de la succession et les droits des héritiers. Cet article explore en détail cette notion sous ses aspects juridiques et pratiques.
Le De Cujus et l’ouverture de la succession
Le décès comme événement déclencheur
L’ouverture de la succession est conditionnée par le décès du de cujus. Conformément à l’article 720 du Code civil, « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Ce principe implique que :
- L’existence juridique du défunt cesse et ses droits patrimoniaux sont transmis à ses héritiers ou légataires.
- Le lieu du dernier domicile détermine les règles de compétence pour la liquidation successorale.
La preuve du décès
La mort du de cujus doit être juridiquement constatée par un acte de décès établi par l’officier d’état civil. Ce document est essentiel pour initier toute procédure successorale.
Dévolution successorale : Qui hérite du De Cujus ?
La transmission du patrimoine du de cujus suit les règles du droit des successions, qui distingue :
- La succession légale, appliquée en l’absence de testament.
- La succession testamentaire, lorsque le de cujus a organisé la transmission de ses biens.
La succession légale
En l’absence de testament, la répartition des biens du de cujus est régie par les articles 734 et suivants du Code civil, qui établissent un ordre de priorité entre les héritiers :
- Les descendants (enfants, petits-enfants) sont les premiers héritiers.
- Le conjoint survivant hérite en l’absence de descendants et en concurrence avec eux selon un ordre spécifique.
- Les ascendants (parents, grands-parents) et collatéraux privilégiés (frères et sœurs) interviennent en cas d’absence de descendants et de conjoint survivant.
- Les autres collatéraux (oncles, tantes, cousins, cousines) ne sont appelés qu’en dernier recours.
La succession testamentaire
Le de cujus peut modifier l’ordre légal de sa succession par un testament, sous réserve du respect des règles impératives, notamment la réserve héréditaire protégée par les articles 912 et suivants du Code civil.
Le testament peut être :
- Olographe (rédigé et signé de la main du testateur).
- Authentique (devant notaire).
- Mystique (remis sous pli cacheté à un notaire).
Liquidation et partage de la succession
L’actif et le passif successoral
La succession du de cujus comprend :
- L’actif successoral : l’ensemble des biens, droits et créances du défunt (immeubles, comptes bancaires, parts sociales, etc.).
- Le passif successoral : les dettes et charges laissées par le de cujus (crédits, impôts, obligations contractuelles).
Les héritiers peuvent :
- Accepter purement et simplement la succession et reprendre l’ensemble des droits et obligations du de cujus.
- Accepter à concurrence de l’actif net, limitant leur responsabilité aux dettes couvertes par l’actif successoral.
- Renoncer à la succession si le passif excède l’actif (article 768 du Code civil).
Le partage successoral
Le partage des biens entre les héritiers peut être :
- Amiable, par un accord entre les héritiers.
- Judiciaire, si un désaccord survient (article 840 du Code civil).
En cas d’indivision successorale, les biens restent communs aux héritiers jusqu’au partage.
Les conflits et contentieux successoraux
L’action en réduction
Si le de cujus a fait des libéralités excessives (donations ou legs portant atteinte à la réserve héréditaire), les héritiers réservataires peuvent demander une réduction (article 920 du Code civil).
Le recel successoral
Un héritier qui dissimule un bien de la succession peut être sanctionné par une privation de ses droits sur ce bien (article 778 du Code civil).
L’indivision conflictuelle
Lorsqu’un héritier bloque le partage, les autres peuvent demander la liquidation judiciaire de l’indivision (article 815 du Code civil).
Régime fiscal de la succession du De Cujus
Droits de succession
Les successions sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit, dont le taux varie selon le lien de parenté entre le de cujus et l’héritier. Les abattements sont prévus par l’article 779 du Code général des impôts (CGI), par exemple :
- Abattement de 100 000 € pour les enfants.
- Abattement de 15 932 € pour les frères et sœurs.
Exonérations fiscales
- Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de succession.
- Les œuvres d’art, immeubles classés, et certains biens agricoles bénéficient d’exonérations spécifiques.
Conclusion
La notion de « de cujus » est centrale en droit des successions, car elle détermine l’ouverture de la succession et la transmission des biens du défunt à ses héritiers. Son régime repose sur des principes fondamentaux tels que l’ordre successoral, le respect de la réserve héréditaire et l’application des droits de succession. Bien que le droit des successions cherche à assurer une transmission fluide et équitable du patrimoine, de nombreux contentieux peuvent survenir, notamment en matière de partage et de libéralités excessives. Une anticipation successorale par testament ou donation permet souvent de sécuriser la transmission et de limiter les conflits familiaux.